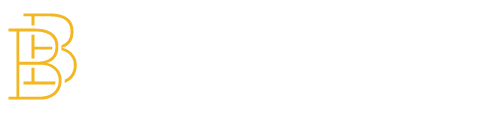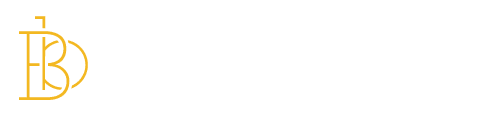Voyage sous la peau
|
Voyage sous la peau |
|
25/03/2019 |
|
fascias, peau |

Découvrez le très beau travail du Dr GUIMBERTEAU:
https://www.youtube.com/watch?v=L5rCuIYlr9o
Après son récent passage à Lyon (22/11/18) pour présenter sa conférence "Promenades sous la peau", le Dr. Jean-Claude Guimberteau nous fait découvrir le corps humain comme nous l'avons rarement vu. Des images sensationnelles de notre (dés)organisation tissulaire (peau, muscles, tendons, nerfs, vaisseaux, os, fascias...), bien loin d'une vision conventionnelle de "l'anatomie étudiée depuis un siècle et demi qui mérite d'être discutée." Alors prêt(e) pour un voyage anatomique en 3D?
Le travail de Jean-Claude Guimberteau sur les fascias a considérablement influencé la compréhension moderne de ces structures dans le domaine médical et ostéopathique. Guimberteau, chirurgien plasticien et spécialiste de la main, a mené des recherches pionnières sur l’architecture et la dynamique des fascias en utilisant des techniques de microchirurgie et des vidéos endoscopiques pour observer les tissus vivants. Son travail a révélé la complexité et la nature multidimensionnelle des fascias, soulignant leur rôle fondamental dans le mouvement et la cohésion du corps humain.
Principaux apports de Guimberteau :
1. La découverte du système fascial en tant que réseau continu :
Guimberteau a montré que les fascias ne sont pas simplement des tissus séparés qui enveloppent les muscles et les organes, mais qu’ils forment un réseau continu qui traverse tout le corps. Ce réseau joue un rôle clé dans la transmission des forces, la mobilité et la stabilité du corps. Il décrit le fascia comme une structure en trois dimensions qui s’adapte en permanence aux contraintes mécaniques.
2. L’importance des fibres et de la matrice extracellulaire :
En observant les tissus vivants, Guimberteau a identifié des microfibres et des structures en réseau dans les fascias qui permettent la transmission des forces et l’adaptation aux mouvements. Ces fibres, baignées dans une matrice gélatineuse, forment une architecture dynamique et flexible, essentielle au bon fonctionnement des tissus.
3. Le concept de “tension optimale” :
L’un des concepts fondamentaux de son travail est que les fascias maintiennent une “tension optimale” qui permet la mobilité et la stabilité du corps sans créer de rigidité excessive. Il a montré comment les tissus fasciaux peuvent s’adapter et se réorganiser en réponse aux mouvements, aux tensions mécaniques et aux traumatismes.
4. Le rôle dans la proprioception et la coordination des mouvements :
Grâce à ses recherches, il est devenu clair que les fascias jouent un rôle central dans la proprioception, c’est-à-dire la perception de la position et des mouvements du corps. En tant que réseau sensoriel, les fascias transmettent des informations cruciales pour la coordination et l’ajustement des mouvements.
Implications pour l’ostéopathie :
Le travail de Guimberteau a des implications directes pour les ostéopathes qui travaillent avec les fascias. En effet, il souligne l’importance de considérer le corps dans son ensemble et de comprendre comment les dysfonctions fasciales peuvent influencer des zones éloignées du site primaire de la douleur ou de la restriction. Les techniques fasciales, utilisées pour libérer les tensions et restaurer la mobilité, s’appuient directement sur les observations de Guimberteau, en tenant compte de l’interconnexion des tissus dans tout le corps.
Il permet de mieux comprendre la complexité du réseau de fascias qui organise le corps humain. On comprend alors la capacité du corps à s'autoguérir après de simples manipulations de l'ostéopathe spécialisé dans l'approche fonctionnelle et biodynamique.
Une pression et un geste adapté à ce qui est ressenti sous la peau du patient permet de stimuler et accompagner cette recherche latente de réorganisation des tissus vivants.
Le concept de Tenségrité développé également dans ce documentaire est véritablement le modèle le plus à même de décrire le fonctionnement du corps humain et la façon dont il utilise la gravité comme force de stabilisation et non de contrainte.
Je vous invite également à consulter:
mon mémoire sur la capsulite rétractile: approche de l'épaule par un modèle de tenségrité
Articles précédents
Partagez sur...